
Dans ce roman, la protagoniste et narratrice Barbara raconte à la première personne sa quête personnelle, celle d’une enfant adoptée, d’une jeune fille puis d’une femme sur les traces de son passé où fiction et réalité s'entremêlent pour former le tissu d’une vérité sur ses parents biologiques dont elle ne sait que quelques bribes d'information.
Tout commence par une lettre anonyme qu’elle reçoit dans laquelle un inconnu lui enjoint de se rendre à l’enterrement de son père biologique, un certain monsieur Steiner, un Français originaire du sud de la France, qui sera enterré à Paris dans le cimetière de Passy. Certaine qu’il ne peut s’agir de son vrai père, elle décide malgré tout de se rendre à cet enterrement, depuis longtemps hantée par les incertitudes sur ses propres origines. Au récit de surface s’intercalent des anecdotes du passé qui lui insufflent le doute quant à l’identité du défunt. L’occasion pour le lecteur d’apprendre au compte goutte nombre de détails sur l’histoire récente, l’adolescence et l’enfance de Barbara, entretenant ainsi le suspense jusqu’à la fin du roman en tenant le lecteur en haleine. Une grande partie de l’action se déroule à Paris. Ces petits récits, emboîtés dans le cours de la narration, transportent le lecteur d’Allemagne en France, à différentes époques de la vie de Barbara et de celle de sa famille adoptive et biologique. Il en résulte un voyage dans le temps, ponctué d’allers-retours incessants dans le présent de la narration effective : période d'entre deux guerres, Seconde Guerre mondiale, de l'après guerre, fin du vingtième siècle et au-delà. Ces incises sont à recomposer par le lecteur, plus d’une fois dérouté, telles différents puzzles à reconstituer. En cela, l’auteur possède quelques points communs avec Nina Bouraoui (notamment dans Mes mauvaises pensées) dont le talent n’est plus à prouver. C’est avec beaucoup de simplicité que Barbara Bongartz nous relate ce récit dans un roman qui possède la texture du polar.

Barbara Bongartz au programme du Buchhändlerkeller le 19 avril 2007
 L'auteur lit quelques extraits choisis de son roman
L'auteur lit quelques extraits choisis de son roman

Barbara Bongartz est née à Cologne en 1957. Elle fait des études de théâtre, de cinéma, d’histoire de l’art et de philosophie à Paris, à Munich et à Cologne. Après avoir vécu à Düsseldorf et à New York, elle s’installe à Berlin en 2003.
Extrait du roman :
« L’inconnu de Passy »
Longtemps j’ai souhaité la mort de mes parents. Parce que je les aimais, ce voeu me faisait honte. Pourtant, aux yeux de la petite fille que j’étais, ce moyen semblait être la seule solution au mal dont souffrait notre famille. Je pensais qu’avec leur mort nous connaîtrions enfin le bonheur et qu’ainsi leurs soucis prendraient fin. Qui ont été mes parents avant de le devenir ? C’est bien trop tard que la question m’a effleurée.
Ils avaient un problème. Ils n’étaient pas en phase avec leur existence, d’où le malaise qui emplissait notre foyer. De la tristesse dans les yeux de ma mère, il suffisait de s’attarder sur sa bouche. De la colère dans la voix de mon père, il suffisait de considérer son regard. En moi un sentiment de culpabilité diffus. De toute évidence quelque chose clochait. C’était du moins mon ressenti. Ils se tourmentaient sans que j’en connaisse la raison. Je me vois courir à cinq ans derrière sa voiture pour le ramener. Je me vois à dix ans au chevet de son lit. Je pense qu’il avait une attaque et se trouvait en danger de mort. J’entends encore les murmures de la famille de ma mère monter du jardin. La nuit, mon père s’absentait quelquefois. Les sanglots de ma mère venaient à mon oreille quand il m’arrivait d’entrouvrir la porte de ma chambre. Mais il m’était interdit d’aller dans la chambre de mes parents la nuit. Néanmoins, à deux ans et demi ou trois ans, je m’y risquai. Pour la première fois, j’eus soudain peur de l’obscurité pendant plusieurs nuits. Le silence et le noir, qui stimulaient d’ordinaire mon imagination, se mirent à me menacer. Ma mère me renvoya dans ma chambre. Je me mis à pleurer, bouleversée par ma solitude et incapable de comprendre pour quelle raison je n’avais pas le droit d’aller la voir. Ma douleur avait dû résonner fort, aussi fort qu’un signal d’alarme car mon père entra dans ma chambre quelques minutes plus tard, hors de lui, et me corrigea.
Il y eut aussi ces curieuses vacances que nous avions passées à Bad Reichenhall. Ce devait être l’été 1963. A Pâques, je venais d’entrer à l’école et il était courant que nous voyagions en dehors des vacances. A peine arrivés dans la ville thermale, l’ambiance entre mes parents se détériora davantage. C’est à peine s’ils s’adressaient la parole. Je me souviens encore du frémissement pénétrant de l’eau jusque dans les recoins de notre hôtel comme si l’endroit n’avait cessé d’être envahi de sauterelles. Ce bruit venait en fait des salines, des parois de bois mort submergées par l’eau. Toute la ville était rythmée par ce bruit de fond si caractéristique qui, après quelques heures, semblait conditionner toute respiration. Même pendant la nuit, l’eau continuait à s’y déverser. Etendue sur mon lit, dans l’impossibilité de trouver le sommeil, je me demandai pourquoi notre famille était si malheureuse en écoutant le bruissement de l’eau.
Ma mère m’expliqua que mon père était très malade et que nous devions le ménager et être très gentilles avec lui. Ce qu’il avait, elle ne le dit pas. Je supposai que c’était quelque chose en rapport avec le cœur parce qu’il s’agrippait souvent à cet endroit. Ce n’est que des décennies plus tard que j’appris que mon père avait alors une maîtresse et que le séjour à Reichenhall était censé mettre un terme à cette liaison.
Elle devint amère, lui imprévisible. Plus la situation s’aggravait, plus je désirais ardemment leur disparition. Je me pris à imaginer des forêts, des fleurs, des prairies, un lac sur lequel le soleil se couchait. Je les voyais enterrés en un lieu paisible, sous une belle stèle recouverte de lierre. Un peu plus tard, l’idée me vint d’un cimetière irlandais ou juif. Les tombes allemandes nécessitaient un soin constant à moins de les négliger. Fleurs coupées, stèle bien astiquée, terre râtelée. Tout ce que je ne voulais pas. Et puis la fête de la Toussaint, en novembre, destinée à honorer les âmes errantes, quand des cortèges entiers défilent au milieu des tombes comme s’il s’agissait de rentrer les moutons pour l’hiver. Je savais que ma mère n’aimait pas non plus cette période. Pourtant, elle ne s’y opposa jamais. Elle faisait ce qu’on attendait d’elle. Jusqu’à aujourd’hui, le qu’en dira-t-on a toujours été son principe fondateur. La plupart du temps, mon père était absent. Elle en profitait pour fouiller sa voiture, ses tiroirs, les poches de son manteau. Ses recherches étaient fréquemment couronnées de succès par un bijou ou une lettre.
Il me semblait que nous étions complètement différents des autres familles. J’étais fille unique et je me sentais très seule, pas seulement quand mes parents partaient en voyage. Et ils s’absentaient longtemps du reste. Je me crispais dès qu’ils faisaient leurs bagages, sortaient les valises de la maison et remuaient leurs mains en guise d’au revoir. Intérieurement, je me pétrifiais en voyant peu à peu disparaître les contours de leurs visages dans le lointain. Je plongeais alors dans un monde imaginaire. Lorsque je croyais ne plus pouvoir le supporter, je m’inventais une autre vie. J’imaginais que nous recommencions depuis le début. Depuis que Victor est en Afghanistan, ce réflexe me reprend. Comme autrefois pendant mon enfance, je me sens perdue. La séparation en est-elle la cause ?
L’automne qui précéda mon déménagement pour Berlin, je me sentis tout aussi désorientée. Mon mariage venait d’échouer. C’est dans ce contexte asphyxiant que j’appris une nouvelle explosive. Je revois devant moi la scène comme on repasse au ralenti des épisodes décisifs où chaque geste peut être décortiqué. Un tic-tac résonne en soi. La récurrence d’une mélodie aux allures de refrain vient s’y superposer. Je revenais de faire des courses et j’attachai mon vélo au réverbère puis rentrai chez moi. La porte de l’appartement grinça. A l’intérieur, le téléphone sonnait. Il me suffit de prendre le combiné pour que la personne à l’autre bout du fil raccrochât. Je sortais pour vérifier le courrier. La boîte était aussi pleine que si je ne l’eus pas ouverte depuis trois jours. Après avoir trié son contenu, j’avisai une lettre. C’était une enveloppe fine, couverte d’une écriture qui m’était inconnue. Tamponnée à Paris. Pas d’expéditeur mais cachetée d’un vernis rouge. Je l’ouvris et compris le seul mot en français du début. Le reste était en allemand, un peu comme dans un film doublé où le public sait qu’il est à l’étranger tout en comprenant ce dont il est question.
Madame(1),
Je pars du principe que le nom que vous portez n’est pas votre nom de jeune fille. Aussi je vous informe par la présente que votre père, M. Alphonse Steiner, sera enterré à Paris vendredi prochain, le 14 décembre, à 8 h 30, au cimetière de Passy. Il s’ensuivra une réception dans la maison du défunt. Je pensais que vous auriez aimé en être informée.
B.
Aucune autre signature. Aucun nom. Aucune adresse. Je ne connaissais aucun B. De quoi s’agissait-il ? D’une plaisanterie ? Mon mariage n’avait jamais entraîné de changement de nom. Mon père ne s’appelle pas Steiner mais Bongartz comme moi. Et il n’a jamais habité Paris de surcroît. C’est un vieil homme qui vit dans un foyer près de la frontière hollandaise avec son énième femme. Il n’est plus en bonne santé et n’a plus d’argent. Voilà des années que je ne l’ai plus vu. Seule sa voix, à présent éraillée, témoignait qu’il était encore en vie lorsqu’il se mit à m’appeler trois ans auparavant. Il avait pris l’habitude de dire sur mon répondeur qu’il désirait me faire ses adieux parce que sa fin était venue. Son timbre était si cassant que je craignais que son corps ne se brisât à tout moment. Je me doutais qu’il n’en était rien car ce n’était pas la première fois qu’il me jouait ce tour. Depuis des années, il m’appelle pour m’annoncer qu’il va bientôt mourir. Par acquis de conscience et le cœur battant, je décidai un jour de contacter l’accueil. Je m’enquis de sa santé. Il va bien, me répondit –on. Il était certes moins alerte qu’autrefois et avait beaucoup maigri, mais il était comme un coq en patte auprès de ces dames qui, toutes, riaient apparemment de ses plaisanteries. On me demanda si je voulais lui parler car il se trouvait justement dans la cafétéria de l’étage inférieur et il était possible de lui signaler mon appel.
A l’époque où je reçus cette lettre, il était encore bien vaillant et sa voix posée. J’ignore dans quelle circonstance son timbre vint à muer. Après tout, quelle importance. J’ai même oublié quand et comment notre relation est venue à changer.
Je me demandais qui était le véritable destinataire de cette lettre et comment mon nom et mon adresse s’y étaient trouvés mêlés. Etait-ce une erreur ? Ou bien y avait-il un quelconque rapport avec moi ? Il est vrai que je connaissais Passy, ayant fait mes études à Paris. J’y avais par la suite tourné des scènes pour un film, également dans le cimetière, avec, pour sujet, une artiste femme oppressée par l’univers masculin. Le mausolée de la peintre Marie Bashkirtseff se trouve tout en haut du cimetière, un lieu pour les pèlerins féministes, les russes en exil et les gens aimant tout particulièrement les histoires glauques. C’est avec une grande facilité que j’ai pu me saisir du thème dans la réalisation de mon film. Marie Bashkirtseff, peintre russe ayant précocement succombé à la tuberculose, incarne pleinement la tragédie d’une artiste apatride trompée par les hommes et les conventions. Son prestige fut entaché de manière perfide. Seule la mort lui conféra une sorte de célébrité macabre. Son caveau est à présent bien plus chargé que son appartement ne l’avait été, sans parler de son atelier. Je m’imagine l’intensité de sa souffrance face à la calomnie. C’est tout cela qui symbolise la présence de son mausolée à Passy. Un cimetière respectable dans le seizième arrondissement, un quartier très chic. La plupart des tombes sont anciennes, des caveaux de famille pour la plupart où reposent plusieurs générations de défunts. Toute une noble société de confessions diverses, même des juifs. Monsieur(2) Steiner n’aurait pu trouver lieu plus exquis comme dernière résidence. Je dois dire que l’idée me plut. La noblesse m’a toujours séduite, ainsi que les dynasties. Les grandes et puissantes familles dont l’histoire n’en finit plus. Comme une promesse faite au destin, ce qui rachetait la douleur de ma mère sur laquelle elle ne pouvait mettre de nom.
« Mais d’où crois-tu venir ? Tu penses certainement être quelqu’un d’important » avait-elle coutume de dire dès lors que je découvrais un élément nouveau qui ombrageait sa conscience. Tout était sujet à disputes. Que ce soit la simple envie de manger une pomme de terre avec sa peau, de porter un foulard de soie en grimpant sur les arbres ou de boire à jeun, de bon matin, un citron pressé. J’éprouvais même du dégoût pour les cheveux permanentés. J’avais un goût prononcé pour les langues secrètes et les noms codés. Ces facéties me prirent alors que j’étais toute petite et inexpérimentée. Longtemps je commis l’erreur de croire que c’était ma manière à moi de me venger du rabaissement que ma mère s’infligeait. Je ne pouvais supporter cet étranglement et cette dégradation d’elle-même mais elle m’entraînait insidieusement dans son triste jeu. Nous étions des êtres de second rang. En conséquence, certains évitaient de nous saluer et beaucoup ne nous voyaient pas (…)
Traduction de Colin Zonska






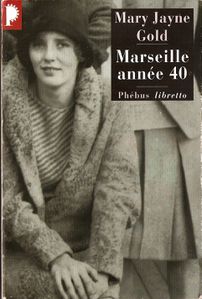
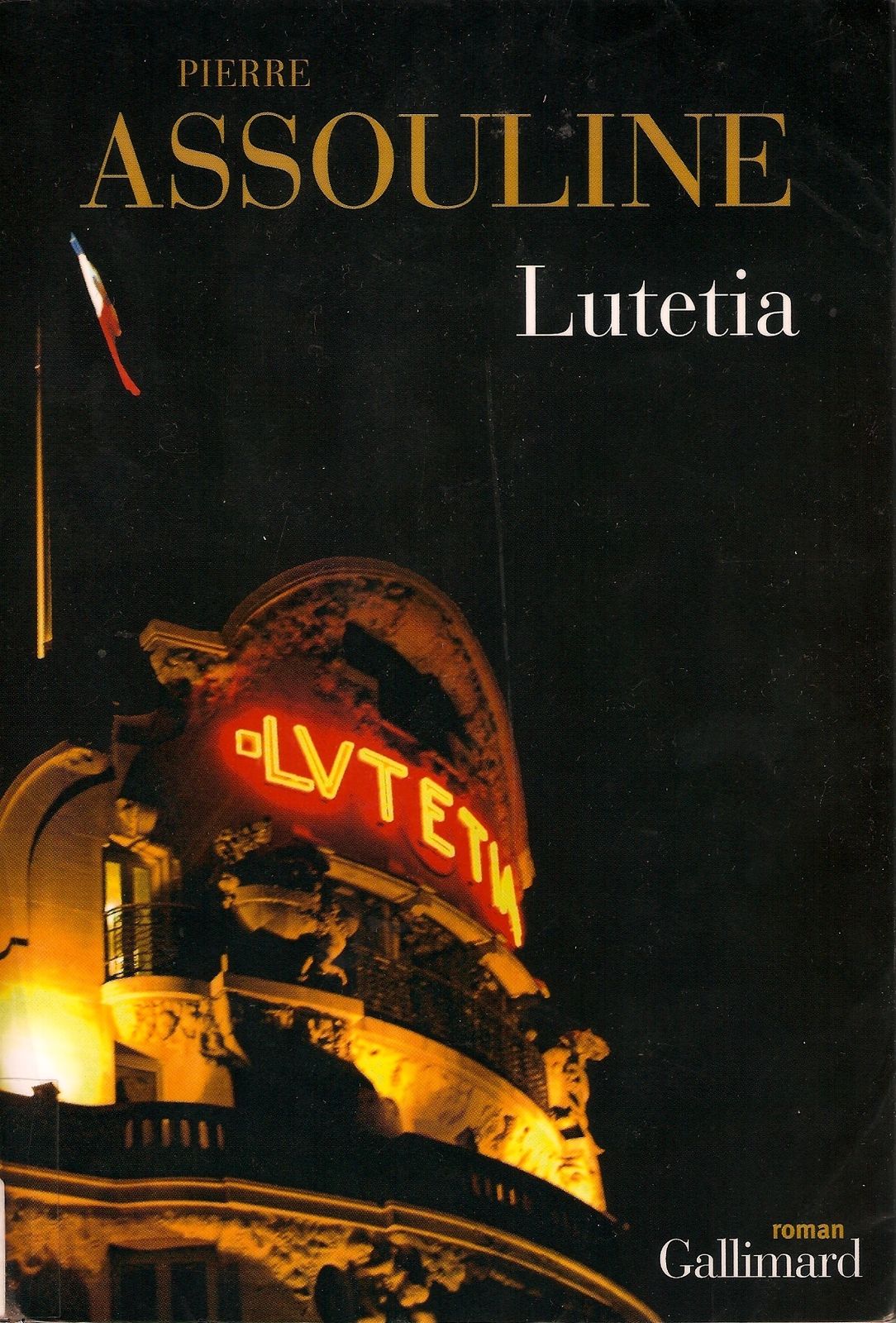





 L'auteur lit quelques extraits choisis de son roman
L'auteur lit quelques extraits choisis de son roman


 Jürgen Tomm, président de l'association. Il travaillait autrefois au sein de la chaîne publique télévisée SFB (Sender Freies Berlin) ancêtre de la RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg). Il présente le roman et l'auteur avant la lecture.
Jürgen Tomm, président de l'association. Il travaillait autrefois au sein de la chaîne publique télévisée SFB (Sender Freies Berlin) ancêtre de la RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg). Il présente le roman et l'auteur avant la lecture.
